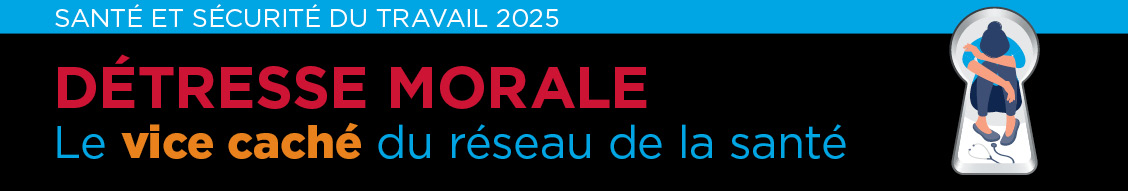
Détresse morale chez les professionnelles en soins : quand la surcharge de travail devient un risque pour la santé psychologique
« 83 % des professionnelles en soins estiment que la charge de travail est le principal facteur dans l’omission de soins. » (Sondage sur les soins non faits, 2023)
Ce constat soulève une question cruciale : que se passe-t-il lorsque les conditions de travail empêchent les professionnelles en soins de respecter les standards de qualité et d’éthique de leur profession?
La réponse tient en deux mots : DÉTRESSE MORALE.
Qualité empêchée : quand bien faire devient impossible
En organisation du travail, le concept de qualité empêchée est souvent utilisé pour mettre en lumière une situation où les conditions de travail ne permettent pas aux employé‑e‑s de réaliser un travail de qualité, malgré leur volonté et leurs compétences. Comme la détresse morale, il s’agit d’un concept qui réfère à la frustration et à la souffrance ressenties face à des obstacles qui empêchent d’effectuer son travail correctement, selon ses standards de qualité. Ce phénomène peut être présent dans tous les milieux.
Capacité à fournir des soins de qualité pour la professionnelle en soins : capacité à exercer ses fonctions de manière efficace, éthique et sécuritaire, en respectant les normes et les pratiques établies par sa profession. Elle inclut la maîtrise des connaissances, des compétences techniques et interpersonnelles, ainsi que l’engagement envers les valeurs éthiques de la profession.
Éthique : une boussole mise à mal
L’éthique est au cœur de la pratique des professionnelles en soins. Elle guide les décisions cliniques, dicte les priorités et donne un sens profond à chaque geste posé. Elle repose également sur les connaissances, les attitudes et les compétences qui permettent d’identifier les préoccupations éthiques inhérentes à leur pratique. Par exemple :
- Effectuer une analyse éthique des actions possibles
- Juger quelles actions sont éthiquement supérieures (ou les moins problématiques dans des situations où toutes les options possibles sont éthiquement problématiques)
- Établir un plan d’action
- Assurer un suivi et une évaluation continue
Lorsque l’organisation du travail entre en contradiction avec ces principes – par exemple lorsqu’une professionnelle en soins doit choisir entre deux patient‑e‑s faute de temps – cette boussole éthique est désorientée. C’est dans cet écart entre ce qu’on devrait faire et ce qu’on peut faire que naît la détresse morale.
La détresse morale survient quand on connaît la bonne action à poser ou la bonne chose à faire, mais que des obstacles et des contraintes organisationnelles empêchent d’agir en ce sens. Elle serait issue du sentiment négatif et du déséquilibre psychologique ressentis par la personne qui se retrouve dans une situation où les actions qu’elle doit accomplir ne coïncident pas avec ses standards professionnels et sa volonté d’offrir des soins de qualité.
Ces situations génèrent une souffrance psychologique intense pour les professionnelles en soins, car elles les confrontent à un dilemme insoluble : respecter leurs valeurs ou obéir aux contraintes organisationnelles.
Ressources - Semaine SST 2025
Conséquences sur la santé mentale et le système de santé
Un facteur aggravant est un élément ou une condition qui intensifie une situation problématique, un état de souffrance ou un risque déjà présent. Voici les principaux facteurs aggravants de la détresse morale :
- Surcharge de travail
- Manque de ressources humaines ou matérielles
- Décisions administratives contraires à l’éthique
- Manque de soutien des collègues ou des supérieurs
- Politiques organisationnelles rigides ou déconnectées de la réalité sur le plancher
- Environnement de travail malsain
- Peur de représailles ou de perdre son emploi en dénonçant des situations
- Crainte de conflits interpersonnels
- Inadéquation entre les valeurs personnelles et les pratiques imposées
- Évènement potentiellement traumatique (code argent, code orange, pandémie, sinistre, etc.)
Trop souvent, les politiques en santé et sécurité du travail se concentrent sur les risques physiques (blessures, chutes, ergonomie) et négligent les facteurs organisationnels qui affectent la santé psychologique et peuvent provoquer :
- Un désengagement émotionnel
- De la culpabilité, de l’impuissance, un sentiment d’échec
- La détérioration de la relation entre la professionnelle en soins et le-la patient‑e
- De l’anxiété, de la frustration, de la colère
La détresse morale peut engendrer des symptômes physiques tels que :
- Des maux de tête
- Des troubles musculosquelettiques (TMS)
- Des troubles du sommeil
Dans les cas les plus graves, la détresse morale peut mener à :
- La dépression
- Le désengagement
- L’absentéisme
- Le roulement de personnel
- L’épuisement professionnel
- L’abandon de l’emploi, voire de la profession
Par le fait même, qu’en est-il des soins non faits? Ou de la charge de travail des professionnelles en soins qui doivent contrebalancer ces absences et ce besoin de main-d’œuvre?
Enjeu central de la santé et de la sécurité au travail
Depuis l’entrée en vigueur de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (LMRSST) le 6 octobre 2021, la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST) est claire :
« [L]’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment s’assurer que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé du travailleur. » (article 51, alinéa 3)
L’employeur est dans l’obligation de protéger tant la santé physique que psychologique du personnel, et il doit donc mener des actions concrètes pour prévenir la détresse morale, au même titre que les risques psychosociaux (RPS) dans les milieux de soins. Ces actions peuvent être :
- Former le personnel à la prévention des RPS
- Encourager l’expression des préoccupations éthiques et professionnelles à travers des dialogues, des comités, etc.
- Assurer un soutien psychologique confidentiel à travers un programme d’aide aux employé‑e‑s
- Impliquer le personnel dans les décisions qui touchent son travail en organisant des rencontres d’équipe régulières par exemple
- Favoriser un climat de travail sain et respectueux
- Agir sur la charge de travail réelle
- Reconnaître et valoriser le travail accompli
- Intervenir rapidement en cas de détresse morale ou de signe d’épuisement professionnel
Que peut faire la professionnelle en soins pour minimiser le risque de souffrir de détresse morale?
- Savoir reconnaître la détresse morale
- Informer son équipe syndicale locale des situations pouvant conduire à la détresse morale afin qu’elle soit partie prenante des actions à entreprendre
- Miser sur le travail d’équipe qui est un facteur de protection essentiel contre les risques en matière de santé et sécurité du travail, dont la détresse morale
- Se référer à son code de déontologie qui peut soutenir la réflexion et les actions en clarifiant les balises de la responsabilité professionnelle
- S’exprimer et rendre imputable les gestionnaires et l’employeur quant à la détresse morale, à ses causes et à ses conséquences
Temps supplémentaire obligatoire pour l’infirmière : mise en situation
Une infirmière effectuant un quart de jour de 8 heures se voit contrainte de rester pour le quart de soir en raison de l’absence d’une collègue. Elle commence à ressentir une fatigue importante et ne se sent pas en pleine possession de ses capacités physiques et mentales pour assurer un autre quart de travail et offrir des soins sécuritaires aux patient‑e‑s.
Deux articles du Code de déontologie des infirmières et infirmiers comportent des contradictions quant aux obligations déontologiques qui s’appliquent dans cette situation.
- En vertu de l’article 44, alinéa 4, l’infirmière est responsable d’assurer la continuité des soins et traitements. En ce sens, avant de quitter, elle doit s’assurer que la continuité des soins sera assurée pour les patient‑e‑s. Cette obligation déontologique peut être invoquée par l’employeur.
- Selon l’article 16, l’infirmière a le droit de refuser d’accomplir une tâche si son état, notamment la fatigue, est susceptible de compromettre la qualité des soins et des services. Ainsi, une infirmière a non seulement le droit, mais aussi le devoir, de refuser un TSO si elle estime que son état met en péril la sécurité des patient‑e‑s.
De son côté, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) établit les balises suivantes :
« L’infirmière est la seule personne qui peut juger si elle est apte à exercer ou non. Son évaluation doit toutefois être empreinte d’honnêteté et d’intégrité. Après avoir évalué sa capacité à exercer ainsi que le contexte dans lequel on lui demande d’effectuer des heures supplémentaires, tels que la complexité des soins, l’état des clients, etc., l’infirmière peut accepter de rester au travail. Si elle juge qu’elle n’est pas en état d’exercer, elle a alors le devoir de se retirer du travail et de refuser de faire des heures supplémentaires. Néanmoins, avant de cesser d’exercer, elle doit :
- aviser son supérieur de sa décision;
- offrir un délai raisonnable pour permettre au supérieur de trouver une solution. »
Cette mise en situation illustre bien les enjeux liés à la détresse morale. L’utilisation des leviers qui sont à sa disposition, tels que le code de déontologie ou les balises prévues par l’ordre professionnel, peut permettre à la professionnelle en soins de mieux faire valoir ses droits afin de diminuer la charge qui lui incombe au quotidien et qui peut devenir source de stress et d’épuisement.
Dans tous les cas, le TSO doit demeurer une mesure exceptionnelle et d’urgence. L’employeur ne peut y recourir pour pallier un manque de personnel prévisible ni pour contraindre une infirmière à travailler au-delà de ses capacités.
Code de déontologie des infirmières et infirmiers
Article 16 : Outre ce qui est prévu à l’article 54 du Code des professions (chapitre C-26), l’infirmière ou l’infirmier doit s’abstenir d’exercer sa profession lorsqu’il est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services. L’infirmière ou l’infirmier est dans un état susceptible de compromettre la qualité des soins et des services notamment s’il est sous l’influence de boissons alcooliques, de stupéfiants, d’hallucinogènes, de préparations narcotiques ou anesthésiques, ou de toute autre substance pouvant produire l’ivresse, l’affaiblissement ou la perturbation des facultés ou l’inconscience.
Article 44 : L’infirmière ou l’infirmier ne doit pas faire preuve de négligence dans les soins et traitements prodigués au client ou au sujet de recherche. Notamment, l’infirmière ou l’infirmier doit :
4° prendre les moyens raisonnables pour assurer la continuité des soins et traitements.
Codes de déontologie
En conclusion : protéger la santé psychologique, c’est protéger la qualité des soins
La détresse morale n’est pas une faiblesse individuelle, mais plutôt un signal d’alarme collectif.
Elle est causée par des choix politiques et de mauvaises décisions de gestion qui engendrent un dysfonctionnement dans l’organisation du travail.
Elle met en péril à la fois la santé des professionnelles en soins et la qualité des soins offerts à la population.
La reconnaître comme un enjeu de SST, c’est faire un pas essentiel vers un système de santé plus humain, plus éthique et plus durable.
La Fédération encourage ses membres à déclarer les situations non sécuritaires pour elles-mêmes ou pour leurs patient‑e‑s en remplissant le formulaire de déclaration d’une situation dangereuse de leur établissement et le formulaire de soins sécuritaires de la FIQ. Ce dernier permet aux professionnelles en soins de signaler à leur syndicat une situation comportant des risques pour la sécurité et la qualité des soins. En documentant les situations problématiques, on se donne les moyens d’agir collectivement pour rehausser la qualité des soins. Entamer une action collective et syndicale pour l’amélioration de la qualité des soins, c’est aussi une façon de se prémunir contre les risques de souffrir de détresse morale.

